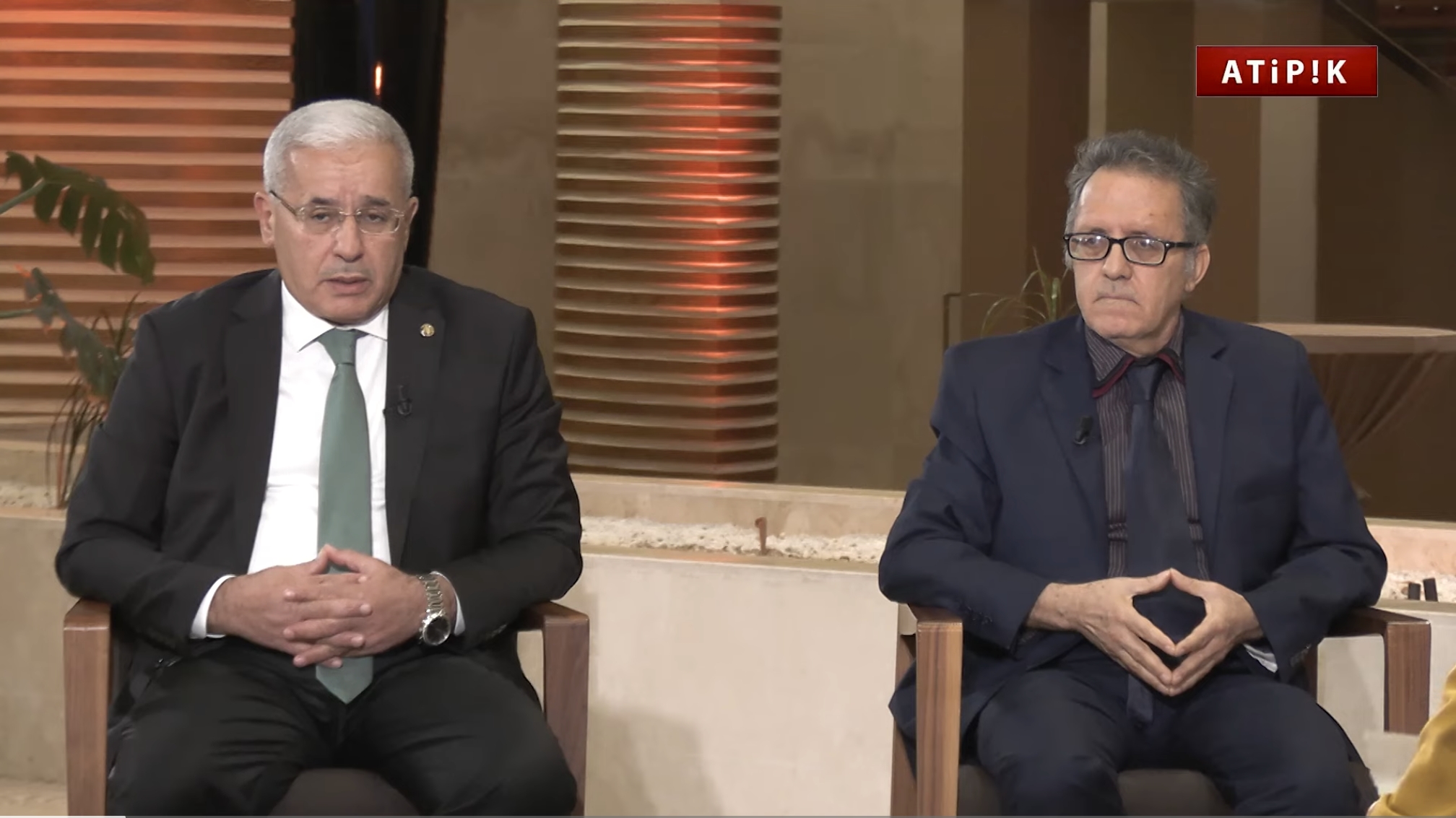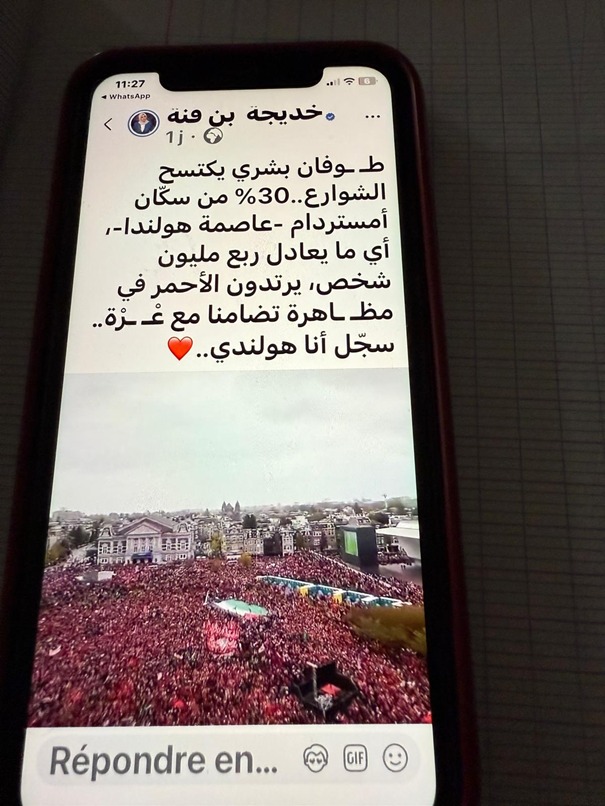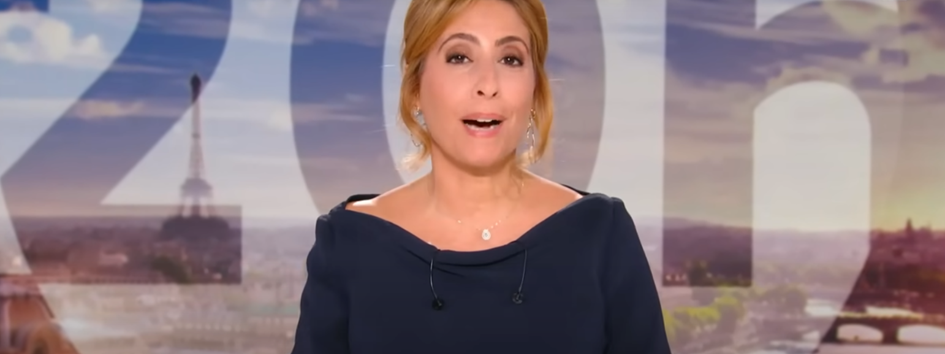Liberté des médias : Retour sur une loi européenne historique, mais un paradoxe persistant à Bruxelles

L’Union européenne a franchi un cap décisif avec l’entrée en vigueur de l’Acte européen sur la liberté des médias (European Media Freedom Act – EMFA), adopté à une large majorité en 2024. Ce texte, voulu par la Commission européenne et salué par le Parlement, marque une étape majeure pour la démocratie européenne. Son ambition est simple : protéger le journalisme de toute influence politique ou économique, garantir la transparence dans la propriété des médias, renforcer l’indépendance des rédactions et mettre un terme aux dérives liées à la surveillance des journalistes.
Ce projet est né d’un constat alarmant. Partout en Europe, la liberté de la presse s’érode. Concentration des médias, interférences politiques, menaces contre les journalistes et usage de logiciels espions ont révélé la fragilité d’un droit pourtant considéré comme fondamental. Pour Bruxelles, il fallait réagir. “La liberté des médias est la pierre angulaire de la démocratie”, a rappelé la Commission en présentant le texte. Le commissaire Michael McGrath s’est félicité de cette avancée, assurant que les citoyens européens pourraient désormais compter sur une information libre, fondée sur les faits, et non dictée par des intérêts commerciaux ou partisans.
Mais derrière les discours, certains observateurs soulignent déjà les limites du dispositif. Sabine Verheyen, eurodéputée allemande du PPE, a prévenu que la valeur de cette loi ne se mesurerait pas à l’aune des promesses, mais à celle de son application concrète. Sa collègue écologiste Nela Riehl a salué une “référence mondiale en matière de liberté de la presse”, tout en exprimant sa crainte face au déclin observable dans plusieurs pays européens. L’EMFA ne sera efficace, a-t-elle insisté, que si les États membres s’y conforment pleinement et sans réserve.
Cependant, un paradoxe demeure : alors même que l’Union européenne se pose en garante de la liberté et de l’égalité des journalistes, ses propres institutions ne traitent pas toujours la presse de manière équitable. Les correspondants accrédités à Bruxelles en font souvent l’expérience. Au Parlement européen, par exemple, les conférences de presse et les ressources audiovisuelles sont largement accaparées par les grands réseaux médiatiques occidentaux. Les petites rédactions, venues d’Europe centrale ou du sud, peinent à se faire entendre. À la Commission, le fameux briefing quotidien du Berlaymont illustre lui aussi un déséquilibre : les journalistes indépendants y voient leurs questions reléguées derrière celles des grandes agences internationales. Quant au Conseil de l’Union, il reste un espace très fermé, où la production d’images et de contenus audiovisuels est soigneusement contrôlée par des équipes internes, laissant peu de marge aux reporters extérieurs.
Ce double discours interroge. Comment l’Union peut-elle exiger des États membres la transparence, la pluralité et l’accès équitable à l’information et aux installations audiovisuelles, si elle-même ne donne pas l’exemple ? La liberté de la presse ne se résume pas à des garanties juridiques, mais à une pratique quotidienne : celle de l’ouverture, du dialogue et de l’égalité d’accès. L’Europe, qui se veut modèle démocratique, ne peut se contenter d’un texte ambitieux. Elle doit aussi veiller à ce que, dans ses propres murs, chaque journaliste — qu’il soit issu d’une grande chaîne ou d’un média indépendant en ligne — puisse exercer son métier dans les mêmes conditions.
L’entrée en vigueur de l’EMFA est sans conteste une avancée majeure. Elle place l’Union européenne à l’avant-garde de la protection du journalisme et envoie un signal fort face aux états où la presse est muselée. Mais sa crédibilité dépendra désormais de sa cohérence. La liberté des médias ne saurait être un principe proclamé d’un côté et contourné de l’autre. Elle doit s’incarner, chaque jour, dans les pratiques de ceux-là mêmes qui prétendent la défendre.