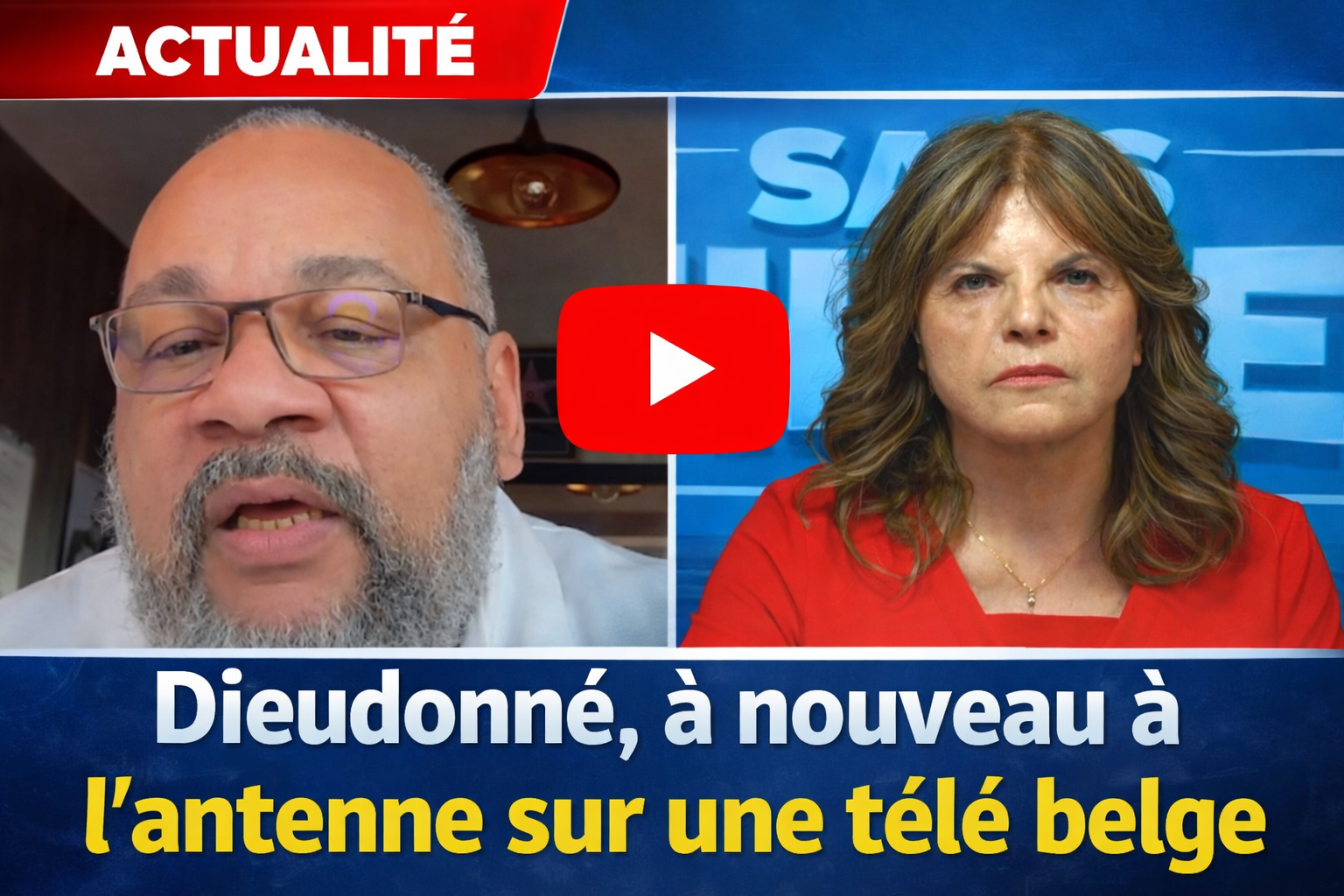Liste grise du GAFI : une alerte technique, pas un désaveu politique pour l’Algérie

Depuis son inscription sur la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI) en octobre 2023, l’Algérie se trouve au centre d’un débat nourri mêlant enjeux techniques, réactions diplomatiques et rivalités régionales. Cette décision, renforcée récemment par l’Union européenne qui a choisi d’aligner ses propres listes sur celles du GAFI, soulève des inquiétudes mais aussi des espoirs de réforme. Contrairement aux lectures alarmistes, cette inscription ne constitue ni une sanction ni un désaveu, mais bien un levier d’accompagnement vers des normes financières plus rigoureuses.
Le GAFI, organe intergouvernemental basé à Paris, évalue les dispositifs des pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans le cas de l’Algérie, les experts ont pointé plusieurs faiblesses structurelles : une transparence insuffisante sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, une surveillance inégale des secteurs sensibles, des déclarations d’opérations suspectes encore peu efficaces, et un cadre légal à renforcer pour le gel des avoirs liés au terrorisme. Ces éléments ne signifient en rien que l’Algérie tolère ou encourage ces pratiques. Ils soulignent plutôt un retard technique dans l’application de dispositifs complexes, souvent coûteux à mettre en œuvre.
Face à cette évaluation, l’Algérie n’est pas restée passive. Bien au contraire, elle a adopté un plan d’action structuré en collaboration avec les experts du GAFI. À Alger, la Banque centrale et plusieurs institutions se mobilisent pour combler les lacunes. Parmi les mesures prioritaires figure la création d’un registre fiable des bénéficiaires effectifs, outil jugé essentiel pour lutter contre les sociétés-écrans et mieux tracer les flux financiers.
Il faut rappeler que d’autres pays, parfois bien plus avancés financièrement, ont également figuré sur cette liste. La Suisse, malgré sa tradition bancaire rigoureuse, y est passée. La France elle-même a connu des remontrances du GAFI dans les années 1990. Plus récemment, les Émirats arabes unis ont été inscrits sur la liste grise avant d’en sortir après des réformes saluées. En juin 2025, l’Union européenne a ajouté l’Algérie à sa propre liste, non pas par jugement politique, mais par souci d’harmonisation avec les critères du GAFI. Cette inscription s’apparente donc davantage à un processus d’ajustement sain, nécessaire pour renforcer la solidité des systèmes financiers mondiaux.
Fait souvent ignoré, trois États membres de l’UE sont eux-mêmes sur la liste grise du GAFI : la Croatie, la Bulgarie et Monaco. À cela s’ajoutent des pays émergents majeurs comme l’Afrique du Sud ou le Vietnam. L’expérience montre que figurer sur cette liste ne signifie ni isolement, ni perte de crédibilité durable, mais appelle des réformes ciblées.
Cependant, cette lecture nuancée est parfois éclipsée par des réactions politisées, notamment chez certains voisins. Au Maroc, une frange des médias a accueilli l’annonce avec une forme de jubilation mal dissimulée. Cette posture s’explique par le contexte de rivalité régionale qui oppose Rabat et Alger, alimentée par des différends historiques autour du Sahara occidental, la fermeture des frontières terrestres et des choix diplomatiques opposés. Dans ce climat, l’inscription de l’Algérie sur la liste grise est parfois utilisée comme un argument d’image, pour suggérer une supériorité économique ou institutionnelle marocaine, même si ce raccourci ne résiste pas à une lecture rigoureuse des faits.
D’autant plus que l’Algérie n’est pas accusée de financer le terrorisme. Le GAFI ne reproche pas une quelconque complicité avec des groupes extrémistes, mais des insuffisances techniques dans l’application des mesures de gel des avoirs et la supervision des circuits financiers. Historiquement, l’Algérie est même reconnue pour sa lutte acharnée contre le terrorisme, notamment durant la décennie noire des années 1990. Elle coopère aujourd’hui activement avec plusieurs grandes puissances — dont les États-Unis et la France — sur les questions de sécurité dans la région sahélienne.
Sur le volet du blanchiment d’argent, les critiques visent surtout le poids considérable de l’économie informelle, qui représenterait plus de 30 % du PIB. À cela s’ajoute la persistance d’un marché parallèle de devises, visible notamment sur des places comme le square Port Saïd à Alger. Des circuits d’import/export peu transparents, une faible bancarisation des échanges commerciaux, et une traçabilité lacunaire compliquent la lutte contre les flux financiers illégaux. Ce n’est pas un problème unique à l’Algérie, mais une réalité partagée par de nombreux pays à économie mixte ou en transition.
En définitive, l’inscription de l’Algérie sur la liste grise du GAFI ne doit pas être vue comme une mise à l’index, mais comme une opportunité de renforcement institutionnel. C’est aussi un test pour la capacité de l’État à mettre en œuvre des réformes structurelles ambitieuses. La feuille de route est claire, les outils sont identifiés, les partenaires internationaux sont prêts à accompagner.
Si la dynamique actuelle est maintenue, une sortie de la liste grise d’ici la fin 2025 ou courant 2026 semble à portée de main. Pour l’Algérie, il s’agit non seulement d’un défi technique, mais aussi d’un enjeu stratégique : renforcer la confiance des investisseurs, améliorer sa réputation financière, et sécuriser davantage son économie dans un monde où la transparence est devenue une condition d’ouverture.