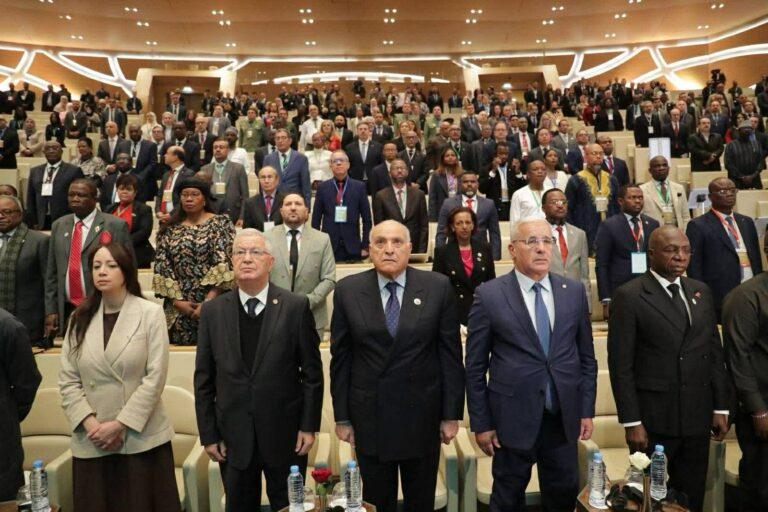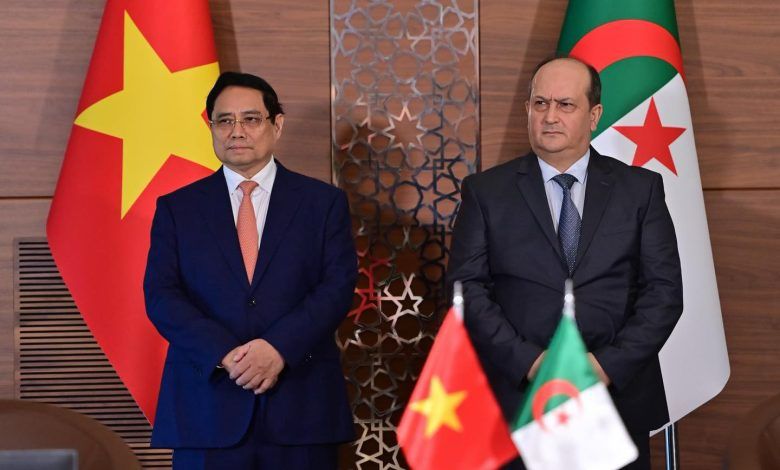France–Algérie : le dialogue impossible

Le 5 juillet, l’Algérie a célébré le 63e anniversaire de son indépendance. À Paris, l’Élysée y a vu une occasion pour le président Abdelmadjid Tebboune de faire un geste symbolique en graciant l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné en appel à cinq ans de prison ferme pour des accusations relevant de la souveraineté nationale algérienne.
Mais du côté français, à deux ans de la fin de son second mandat, Emmanuel Macron n’a, une fois de plus, pas saisi l’opportunité de briser le mur du silence. Un silence assourdissant sur l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire coloniale : les essais nucléaires français en Algérie, menés entre 1960 et 1966, d’abord à Reggane, à l’air libre, puis dans les galeries d’In Ekker.
Le 1er mai 1962, l’essai raté baptisé Béryl a provoqué une fuite massive de particules radioactives, exposant soldats, nomades et populations locales à un nuage toxique. D’autres essais auraient également connu des dysfonctionnements, selon plusieurs sources. Pourtant, aucun bilan humain complet n’a jamais été établi. La contamination des sols sahariens, elle, est irréversible pour des millénaires.
À ce jour, aucune négociation sérieuse sur des réparations n’a été engagée. La France a quitté l’Algérie sans reconnaître les conséquences de ses actes, ni sur les corps, ni sur les terres. Et ce déni historique se poursuit dans le silence complice des médias français, tous bords confondus.
Si l’omerta peut s’expliquer du côté des chaînes appartenant à Vincent Bolloré, très proches du Rassemblement national et ouvertement hostiles à l’Algérie, elle étonne davantage chez France Inter ou France Culture, censées incarner un service public éclairé. L’indépendance éditoriale de nos grandes radios mériterait, à ce titre, d’être interrogée.
Il reste aux derniers témoins de cette époque de porter le fardeau du devoir de mémoire, dans une France où la page de la colonisation semble non seulement tournée, mais volontairement arrachée.