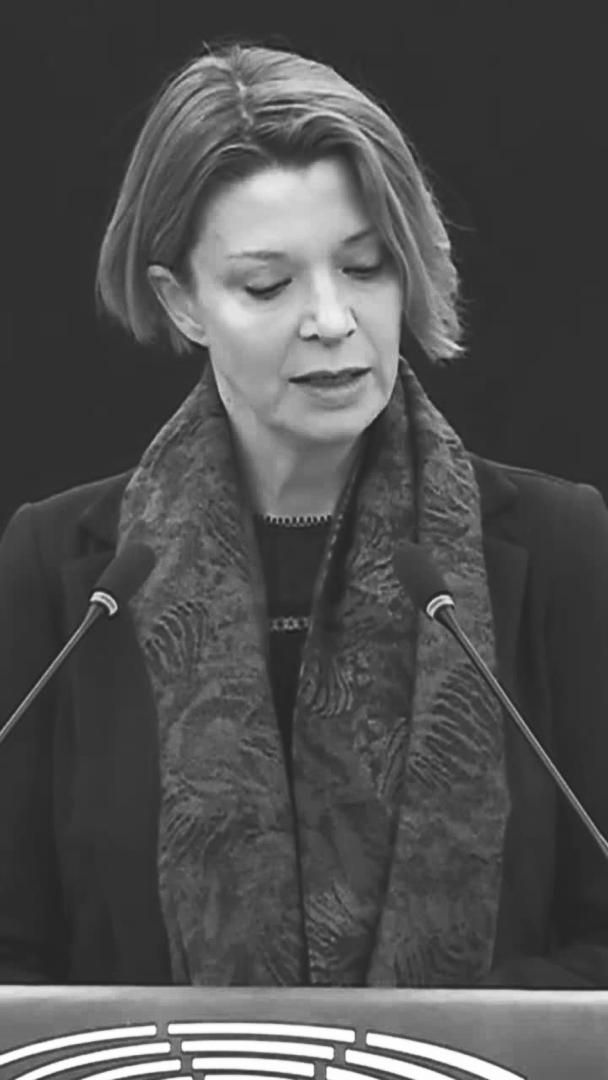L’exfiltration du président malgache par la France : entre ingérence et devoir de protection

L’exfiltration du président malgache Andry Rajoelina, le 12 octobre 2025, par les forces françaises, restera gravée comme l’un des épisodes les plus spectaculaires et controversés de l’histoire politique récente de Madagascar. En quelques heures, le chef de l’État a été évacué de son palais d’Iavoloha, escorté par des militaires français, avant d’être transféré à bord d’un avion à destination de Paris. Un départ sous tension, une nuit qui a bouleversé la nation
Cette scène, digne d’un thriller géopolitique, a fait l’effet d’un choc dans tout le pays. Pour beaucoup, voir le président quitter le territoire sous la protection d’une ancienne puissance coloniale symbolisait la fragilité d’un État encore prisonnier de son passé.
L’ombre de l’histoire : la France, arbitre malgré elle ?
Depuis son indépendance en 1960, Madagascar vit au rythme de crises politiques récurrentes. Rivalités de clans, ambitions personnelles, méfiance populaire et instabilité institutionnelle ont souvent ouvert la voie à des interventions extérieures.
La France, liée à Madagascar par l’histoire, la langue et les intérêts économiques, s’est régulièrement retrouvée dans une position ambiguë : à la fois protectrice et suspecte d’ingérence.
Dans le cas de Rajoelina, Paris a justifié son intervention par la nécessité d’éviter un bain de sang, après que des factions militaires rebelles eurent encerclé la capitale. Pourtant, pour de nombreux observateurs malgaches, cette opération rappelle les heures sombres de la Françafrique, où Paris tirait les ficelles depuis les coulisses.
Ingérence ou protection ? Les deux visages d’un même geste
Officiellement, l’exfiltration répondait à un impératif humanitaire : sauver un dirigeant menacé, éviter un effondrement institutionnel, protéger la stabilité de la région.
Mais derrière le langage diplomatique, beaucoup y voient un calcul stratégique. Madagascar occupe une position géopolitique essentielle dans l’océan Indien, au carrefour des routes commerciales, des enjeux environnementaux et des rivalités entre puissances.
Pour la France, laisser s’effondrer un partenaire politique — même affaibli — aurait signifié perdre un point d’ancrage dans une zone clé. En sauvant Rajoelina, elle sauvait peut-être aussi une part de son influence.
La colère du peuple : entre humiliation et réveil national
Dans les rues d’Antananarivo, l’annonce de l’exfiltration a provoqué une onde de choc. Des manifestations spontanées ont éclaté, mêlant colère, incompréhension et sentiment d’humiliation nationale.
Beaucoup de Malgaches ont perçu ce départ précipité comme un abandon, voire une trahison. Certains scandaient : “Nous n’avons plus de président, nous avons un fuyard !”
D’autres y voyaient le symbole d’un pays toujours sous tutelle, incapable de résoudre ses propres crises sans l’intervention de la France. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les caricatures et slogans se multipliant : “Rajoelina s’envole, la souveraineté s’effondre.”
Pour une jeunesse déjà désillusionnée par la corruption et les promesses non tenues, cet épisode a ravivé une profonde frustration. Il a aussi déclenché une vague de réflexions sur l’indépendance réelle de Madagascar, poussant certains mouvements citoyens à réclamer une refondation politique et une rupture claire avec les ingérences étrangères.
Un lien historique en quête d’équilibre
L’exfiltration du président Rajoelina ne marque pas seulement un tournant politique ; elle redéfinit aussi la nature des relations entre Paris et Antananarivo.
La France, en agissant ainsi, a voulu éviter le chaos. Mais elle a aussi ravivé les blessures d’un passé colonial jamais totalement refermé.
Pour Madagascar, ce drame national pourrait devenir un catalyseur : celui d’une prise de conscience collective, d’un appel à la souveraineté réelle, d’un désir de s’émanciper enfin des influences extérieures.
Entre ingérence et devoir de protection, la frontière est fine — et, dans cette nuit d’octobre 2025, elle a été franchie aux yeux d’un peuple qui, désormais, réclame de tracer lui-même son destin.