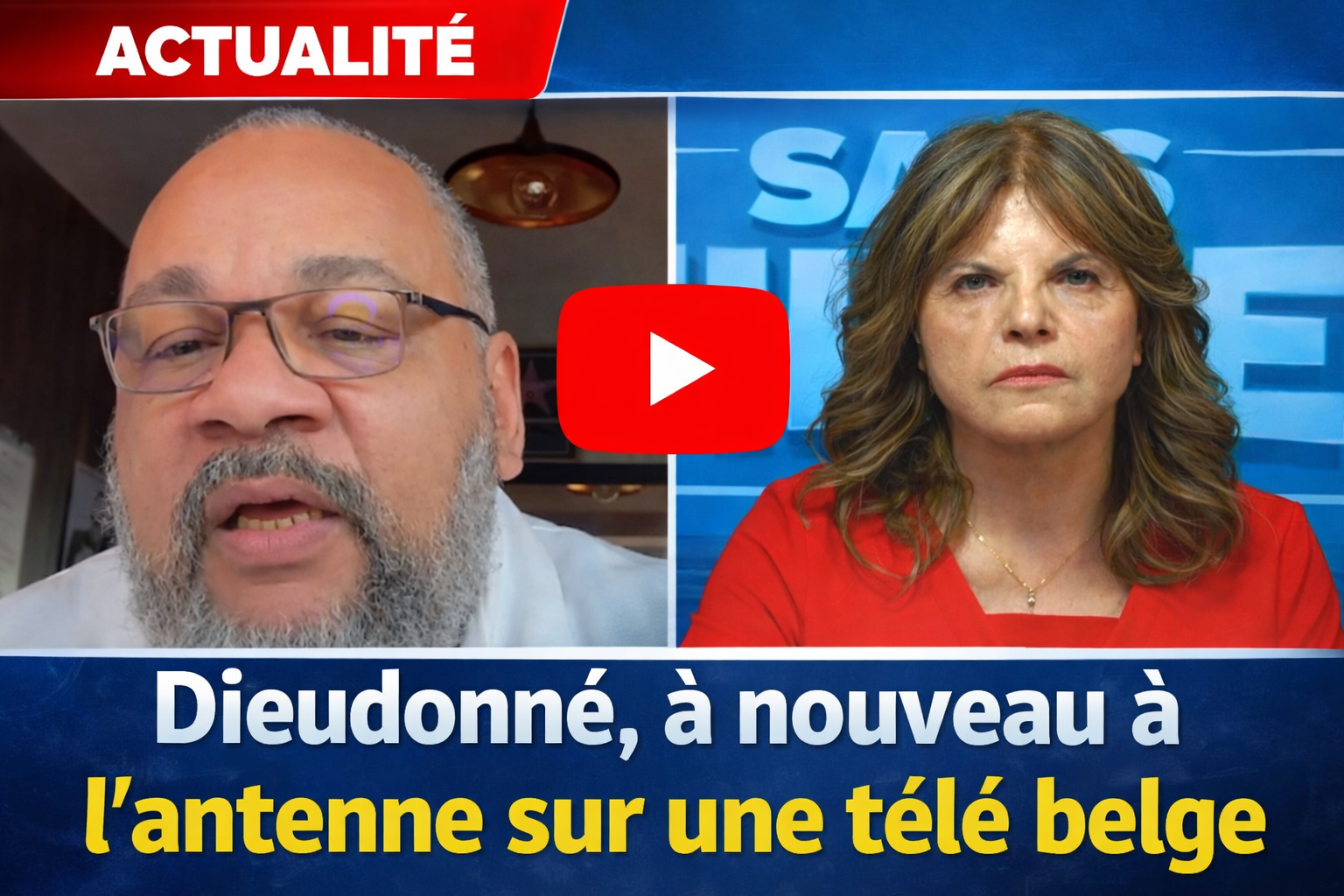L’UE lance un ambitieux “Pacte pour la Méditerranée”, mais est-ce vraiment la nouveauté qu’on attendait ?

Qui dit pacte dit en principe mettre ensemble les deux rives de la Méditerranée : dialoguer, réfléchir, échanger et enfin décider ensemble d’un projet gagnant-gagnant. Mais sur le nouveau “Pacte pour la Méditerranée” dévoilé ce jeudi par la Commission européenne et la Haute Représentante, certains observateurs, comme le retraité et professeur Bichara Khader, n’hésitent pas à pointer du doigt un modèle encore très européen : « L’Europe propose, impose et dispose ».
Quoi qu’il en soit, le projet s’appuie sur des liens historiques et culturels solides et ambitionne de créer un espace méditerranéen commun, connecté, prospère, résilient et sûr. Mais alors, cette initiative est-elle vraiment nécessaire ? Et que devient l’Union pour la Méditerranée (UpM), créée dans le cadre du processus de Barcelone et de la politique européenne pour la Méditerranée (PEV) ?
Trois piliers pour une coopération renforcée
Le pacte repose sur trois piliers, censés refléter copropriété, cocréation et responsabilité conjointe, avec un accent mis sur les initiatives concrètes :
1. Les personnes comme moteur du changement
Éducation, emploi, culture, mobilité : le pacte met fortement l’accent sur les jeunes et la société civile. La création d’une université méditerranéenne reliera étudiants et enseignants de toutes les rives. Le renforcement des formations techniques et professionnelles, ainsi que la promotion du patrimoine culturel et touristique, vise à soutenir les artistes et relancer le tourisme durable.
2. Des économies plus fortes, durables et intégrées
Ce pilier cible la modernisation des relations commerciales et d’investissement, les énergies renouvelables et technologies propres, la résilience dans le domaine de l’eau, l’économie bleue, l’agriculture et la connectivité numérique. Parmi les projets phares figurent T-MED, initiative transméditerranéenne sur les énergies propres, et StartUp4Med, pour soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat. L’intégration des chaînes d’approvisionnement et des infrastructures numériques doit rapprocher les économies et les citoyens.
3. Sécurité, préparation et gestion des migrations
Le pacte entend renforcer la coopération en matière de sécurité, préparer la région aux catastrophes et gérer les flux migratoires. La création d’un forum régional sur la paix et la sécurité est annoncée pour coordonner l’action entre l’UE et les pays du Sud méditerranéen, tandis que la lutte contre le trafic de migrants sera une priorité.
Une ouverture au-delà du pourtour méditerranéen
Le pacte ne se limite pas aux rives sud et nord de la Méditerranée. Il vise également à impliquer le Golfe, l’Afrique subsaharienne, les Balkans occidentaux et la Turquie, dans une logique de coopération renforcée avec le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Vers un nouveau souffle ou une redite ?
Le Pacte pour la Méditerranée s’inscrit dans la continuité du processus de Barcelone, lancé en 1995, et du programme pour la Méditerranée de 2021. Mais cette initiative pose question : apporte-t-elle vraiment du neuf par rapport à l’Union pour la Méditerranée (UpM) ou à la PEV ? Certains analystes jugent que l’UpM, trop institutionnalisée et souvent critiquée pour son manque d’efficacité concrète, n’a jamais pleinement réussi à fédérer les deux rives. Le nouveau pacte semble vouloir corriger ces limites en misant sur des projets concrets, des chaînes d’approvisionnement intégrées, et un focus sur les jeunes et les PME.
Le projet sera soumis à approbation politique en novembre 2025, à l’occasion du 30e anniversaire du processus de Barcelone. Un plan d’action détaillé, prévu pour le premier trimestre 2026, précisera les pays et parties prenantes pour chaque initiative. Les organisations régionales, la société civile et les jeunes seront appelés à soutenir sa mise en œuvre, dans une tentative de rendre cette démarche plus inclusive et pragmatique que ses prédécesseurs.
L’intention de Bruxelles est claire : renforcer ses relations avec le Sud méditerranéen tout en modernisant la coopération économique et sécuritaire. Mais la question reste entière : ce pacte saura-t-il enfin équilibrer le dialogue entre les deux rives, ou restera-t-il une initiative essentiellement européenne qui propose et dispose ?