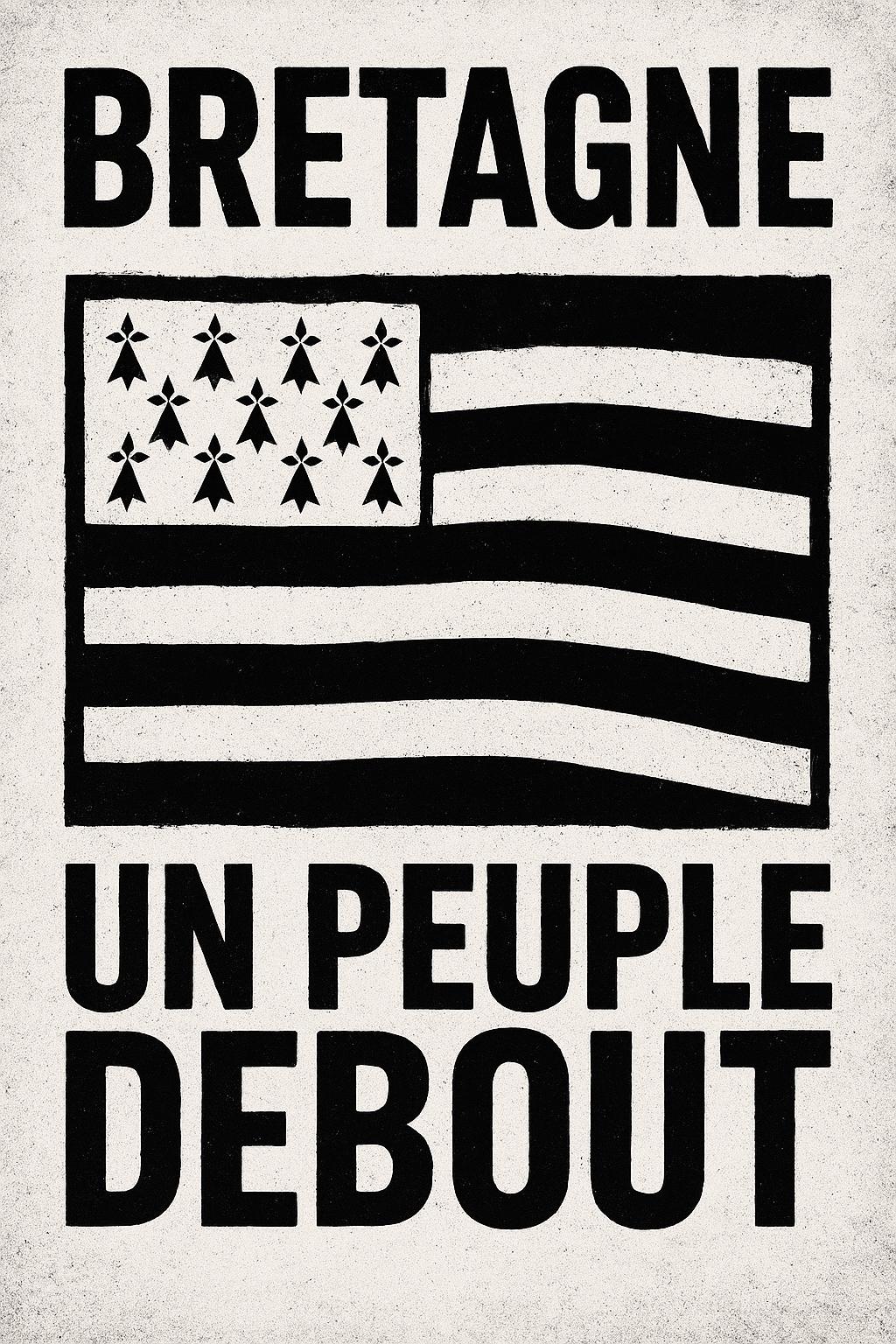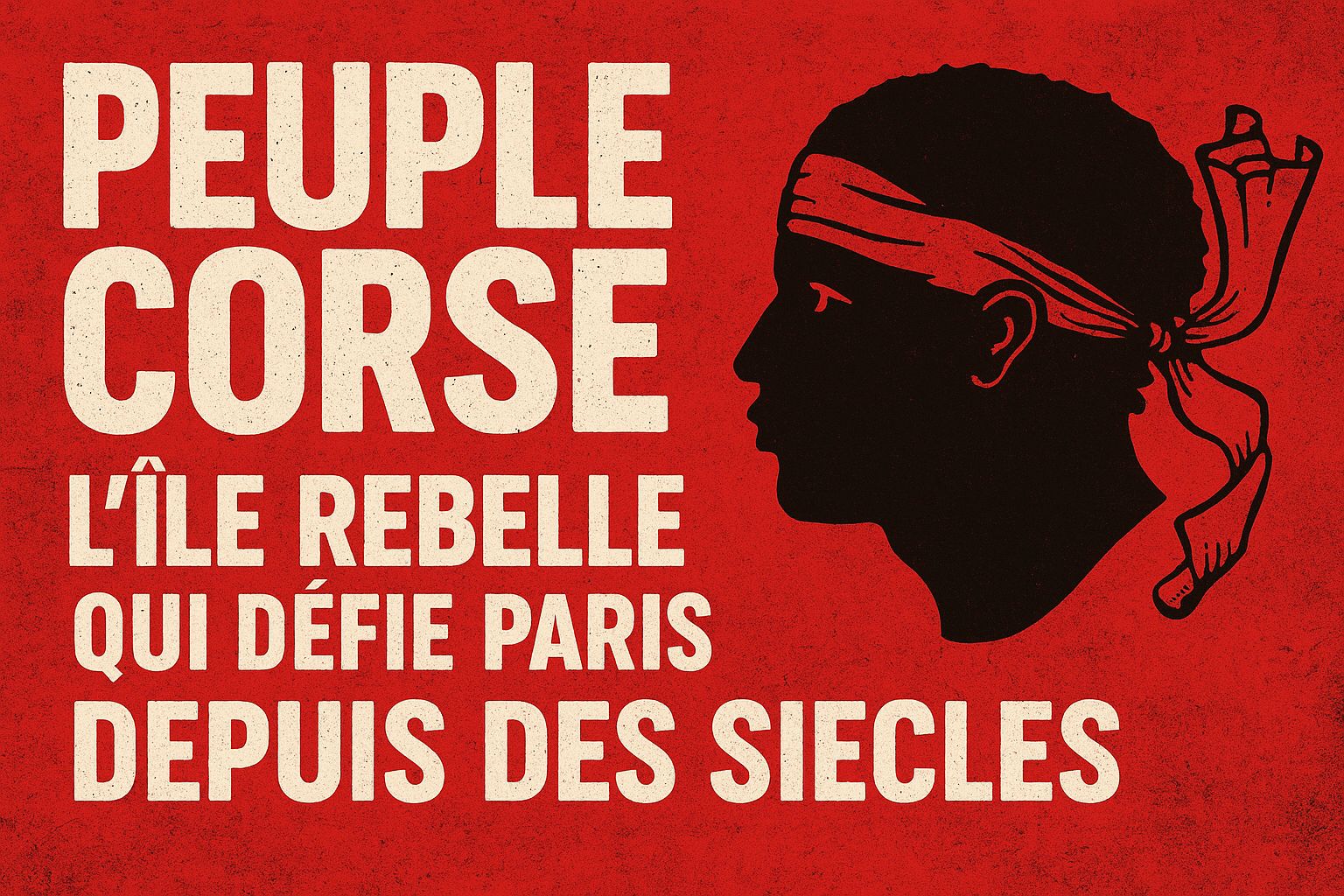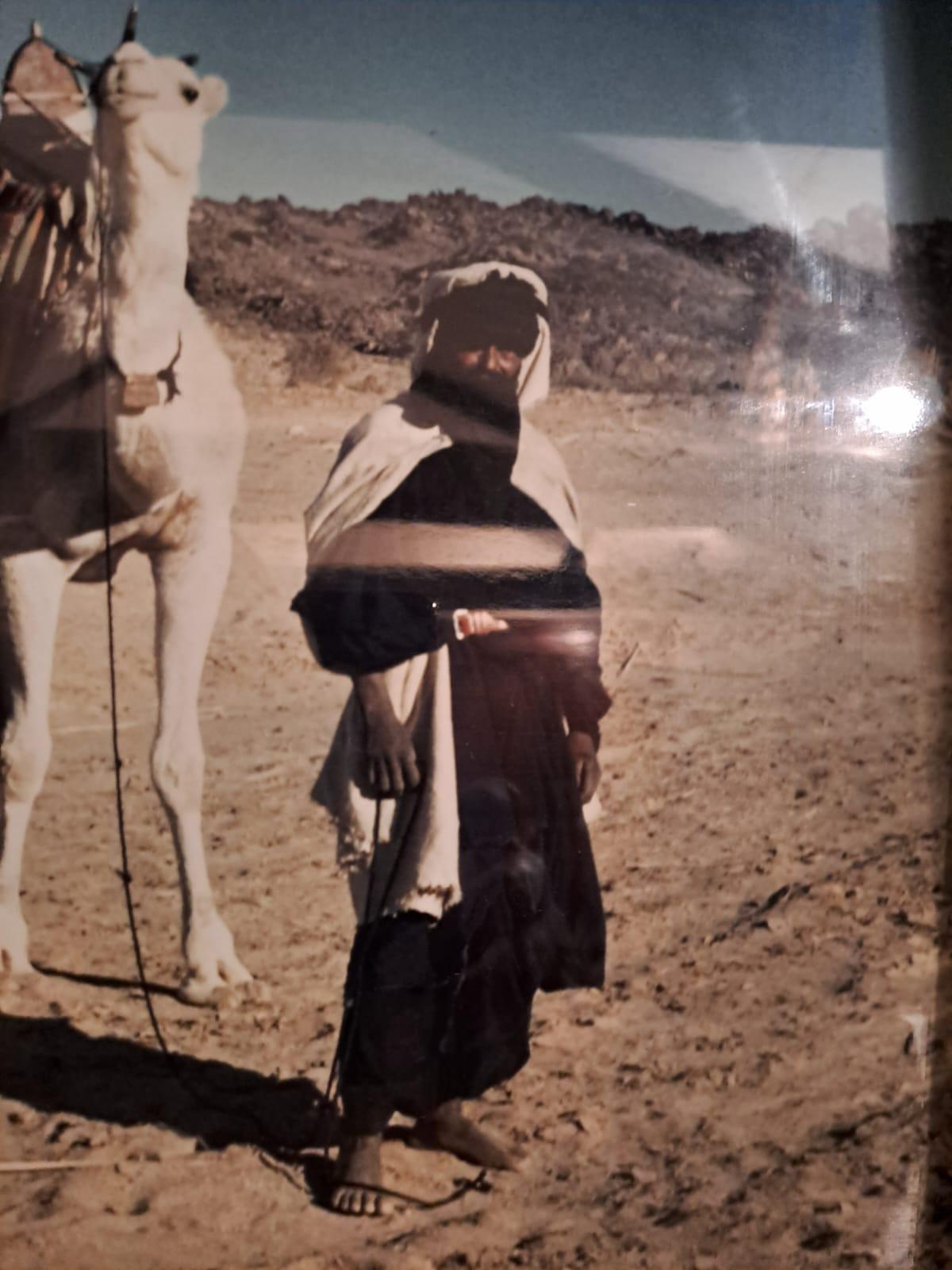Molenbeek : du foyer djihadiste au bastion des narco-réseaux marocains

Une commune sous les projecteurs depuis 2015
Molenbeek-Saint-Jean, commune populaire de Bruxelles, traîne depuis une décennie une réputation qui dépasse largement les frontières belges. Son nom reste associé aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars 2016 à Bruxelles. Les enquêteurs avaient alors établi que plusieurs membres des commandos terroristes, dont Salah Abdeslam, Abdelhamid Abaaoud et Najim Laachraoui, vivaient ou avaient transité par Molenbeek. La plupart étaient d’origine marocaine.
Ces connexions avaient mis en lumière l’existence, au cœur de la capitale européenne, d’un terreau favorable à la radicalisation islamiste, alimenté par un fort isolement social, un chômage élevé et des réseaux communautaires fermés.
Un ghetto urbain, fracture sociale et enclavement
Avec plus de 97 000 habitants sur seulement 6 km², Molenbeek est l’une des communes les plus denses de Belgique. Plus de la moitié de sa population est issue de l’immigration marocaine, arrivée massivement dans les années 1960-1970 pour travailler dans l’industrie.
L’effondrement de l’emploi industriel et l’absence de politiques d’intégration efficaces ont progressivement transformé certains quartiers en ghettos urbains, où l’emprise communautaire et religieuse est forte. Dans ce climat, un certain nombre de jeunes ont été happés par des idéologies radicales ou par la criminalité organisée.
Des réseaux terroristes aux narco-mafias
Si le pic de la menace djihadiste a reculé depuis 2017, la commune reste un point névralgique pour un autre fléau : le trafic de drogue. Ces dernières années, la Belgique est devenue une plaque tournante du commerce de cocaïne en Europe, en raison notamment du port d’Anvers.
Des réseaux mafieux, souvent dirigés par des criminels belgo-marocains, contrôlent une partie de l’importation et de la distribution. Plusieurs figures de ces organisations, comme Othman El Ballouti, ont fait la une des journaux. Les guerres de territoire se traduisent par des fusillades, parfois en plein jour, comme celle survenue samedi dernier à Molenbeek, où un homme a été hospitalisé après avoir été touché par balle. Les circonstances exactes restent floues, mais ce type d’incident est loin d’être isolé.
Un climat d’insécurité récurrent
Depuis deux ans, Bruxelles et Anvers connaissent une série d’attaques à l’arme à feu, d’explosions et d’incendies criminels liés au narco-trafic. Les autorités parlent d’une “guerre de gangs” importée des méthodes sud-américaines. Molenbeek, par sa densité, ses réseaux de solidarité communautaire et ses zones difficiles à pénétrer pour la police, sert de refuge ou de base logistique à certains de ces groupes.
Malgré les arrestations et les saisies record de cocaïne au port d’Anvers (plus de 120 tonnes en 2024), la dynamique criminelle reste forte. Les bénéfices colossaux du trafic permettent aux organisations de recruter facilement, notamment parmi une jeunesse en rupture sociale.
Les autorités sur la défensive
Face à cette double réputation — berceau du terrorisme hier, fief des narco-mafias aujourd’hui — les autorités belges tentent de redresser l’image de Molenbeek. La commune bénéficie de programmes de “réhabilitation urbaine” et de renforcement policier. Des cellules de renseignement travaillent en lien avec Interpol et Europol pour cartographier les réseaux.
Pourtant, sur le terrain, les habitants restent partagés : certains dénoncent la stigmatisation médiatique, d’autres estiment que la criminalité gangrène toujours leur quotidien. Entre sentiment d’abandon et réalités criminelles, Molenbeek continue d’incarner un paradoxe européen : celui d’une commune à deux pas des institutions de l’UE, mais qui peine à sortir de l’ombre de ses démons.