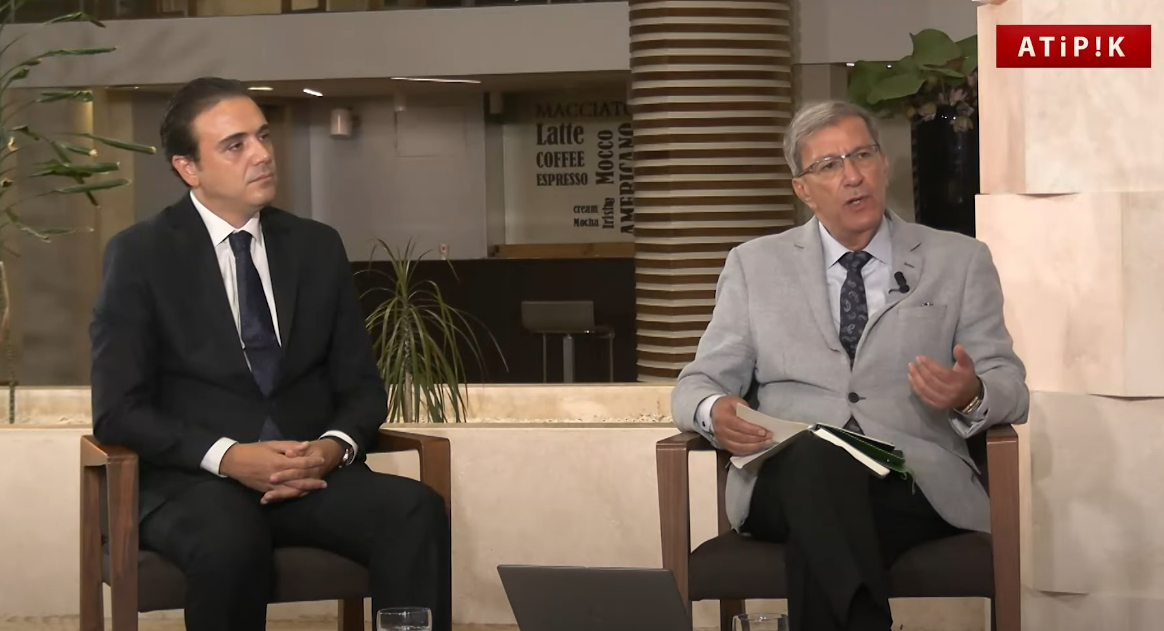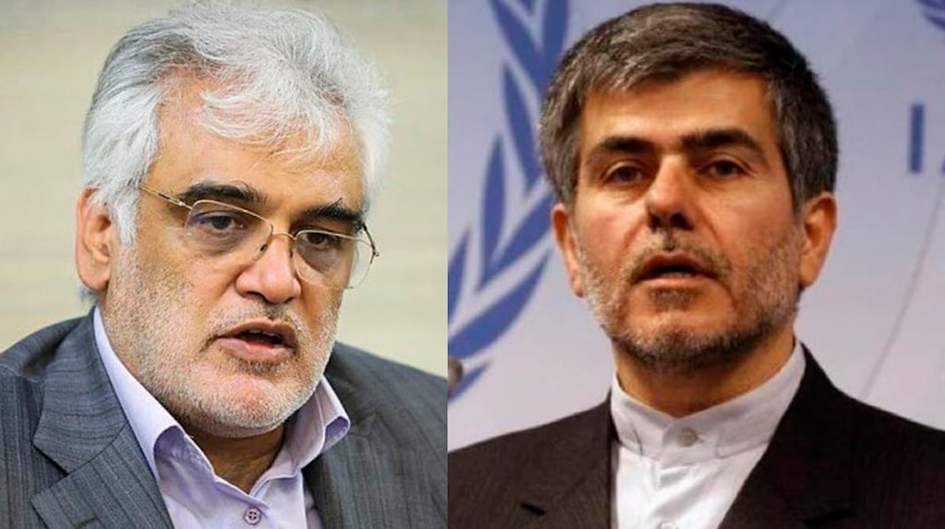Algérie-France : Du franc symbolique à l’affront symbolique

Les relations entre l’Algérie et la France, déjà tendues, viennent de connaître un nouveau tournant symbolique. L’Algérie veut actualiser la valeur des biens immobiliers loués à la France, incluant l’ambassade et la résidence de l’ambassadeur, et a convoqué une nouvelle fois l’ambassadeur français en moins d’un mois. Une décision qui ne manque pas de souligner la détérioration des liens diplomatiques, exacerbée par la prise de position du président français, Emmanuel Macron, en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara, en juillet dernier.
Le dossier des biens immobiliers : une asymétrie révélatrice
Le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué M. Stéphane Romatet, l’ambassadeur de France en Algérie, pour exposer un dossier longtemps ignoré par Paris : celui des biens immobiliers occupés par la France sur le sol algérien. Selon l’agence de presse officielle algérienne (APS), ce dossier met en lumière une disparité flagrante entre les deux nations. En effet, la France occupe 61 biens immobiliers en Algérie, dont certains sont loués à des prix dérisoires. Parmi eux, l’ambassade de France à Alger, située sur 14 hectares de terrain avec un loyer si bas qu’il ne couvrira même pas le coût d’une chambre de bonne à Paris. De même, la résidence de l’ambassadeur, située sur 4 hectares, était louée au « franc symbolique » jusqu’à son actualisation en août 2023.
Un héritage d’accords unilatéraux
La question des biens immobiliers n’est qu’un aspect d’une relation asymétrique plus vaste entre les deux pays. Selon l’APS, plusieurs accords bilatéraux ont permis à la France de bénéficier de conditions très favorables en Algérie, tout en imposant à ce pays des termes nettement moins avantageux. L’exemple le plus frappant est celui de l’accord de 1968, qui régit le statut des Algériens en France et leur accorde un régime migratoire dérogatoire. Bien que cet accord soit fréquemment critiqué par la France, l’agence de presse algérienne rappelle que la main-d’œuvre algérienne a largement contribué à la reconstruction et au développement économique de la France, sans que l’Algérie n’ait bénéficié d’avantages similaires.
L’accord de 1994, qui encadre la coopération entre les deux pays en matière de commerce et d’investissement, est également cité comme un exemple d’avantages disproportionnés pour la France, tandis que les opportunités pour les entreprises algériennes en France restent limitées.
Le paradoxe de la réciprocité
L’APS a réagi avec force contre les accusations portées par certains membres de l’extrême droite française, notamment Bruno Retailleau, qui accusent l’Algérie de ne pas respecter les accords passés et de profiter des aides françaises. « Si Paris souhaite réellement ouvrir le débat sur la réciprocité et le respect des engagements signés, alors parlons-en ! » a rétorqué l’agence officielle, soulignant que l’heure est venue de mettre fin à l’hypocrisie. Selon l’APS, c’est la France qui, depuis des décennies, a profité de chaque accord signé, tirant systématiquement parti des avantages au détriment de l’Algérie.
Une relation marquée par l’inégalité
Ce retour sur les accords bilatéraux met en lumière un déséquilibre structurel dans les relations franco-algériennes. L’Algérie, malgré ses sacrifices, n’a jamais bénéficié d’une réciprocité équitable. Au contraire, elle a été utilisée comme un levier au profit de la France, qui a su exploiter chaque opportunité pour renforcer sa position économique et politique. Si la France exige aujourd’hui un retour sur ses investissements en Algérie, elle devra d’abord rendre des comptes sur la manière dont elle a, à son tour, profité de cette relation.
L’Algérie, une voix qui s’élève
L’Algérie semble prête à réaffirmer sa souveraineté et à ne plus se laisser manipuler par des discours fallacieux. L’actualisation de la valeur des loyers des biens immobiliers et la convocation de l’ambassadeur français ne sont que des gestes symboliques, mais puissants, qui traduisent une volonté de remettre en question les rapports de force inégaux qui ont caractérisé la relation entre les deux pays depuis des décennies.
En somme, le temps de l’« affront symbolique » est venu. La France devra désormais répondre aux questions de réciprocité et de respect des engagements, si elle souhaite éviter que cette relation ne se détériore davantage.