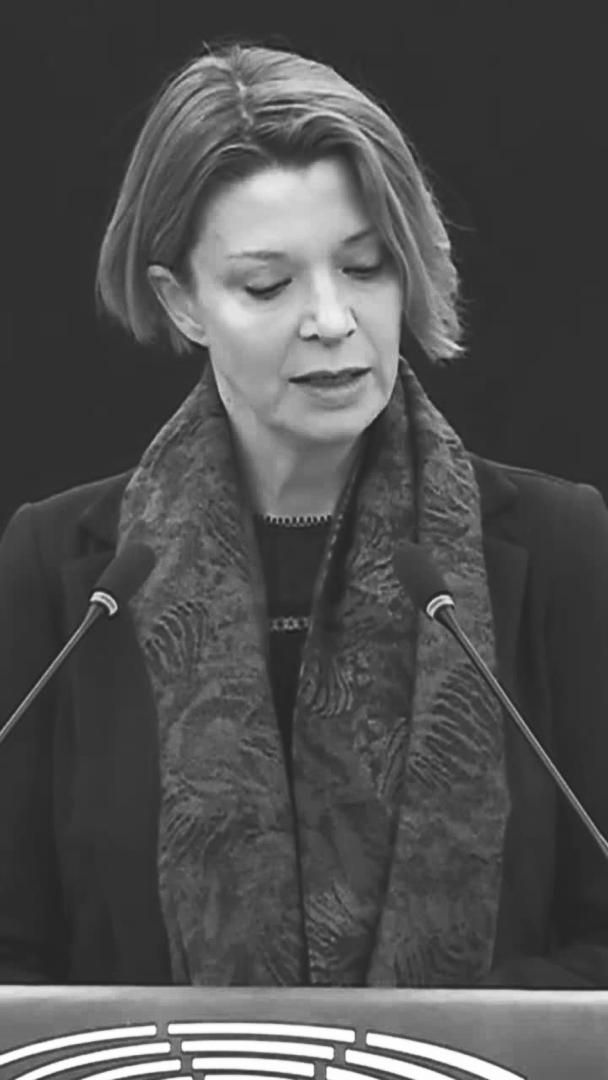Boualem Sansal, miroir trouble des relations franco-algériennes

Paradoxalement encensé en France et souvent rejeté en Algérie, Boualem Sansal cristallise des tensions postcoloniales profondes. Mais derrière le romancier engagé, se dessine une figure plus complexe, voire ambiguë, dont les silences sont parfois aussi parlants que ses mots.
Parmi les écrivains algériens contemporains – je mets des pincettes sur le moh écrivain concernant Sansal – , Boualem Sansal occupe une place singulière. Ancien haut fonctionnaire, ingénieur et docteur en économie, il est devenu au fil des années une voix régulièrement sollicitée dans les médias français pour commenter l’actualité algérienne, les questions liées à l’islamisme, à la liberté d’expression, et aux échecs du monde arabe. Adoubé par l’intelligentsia française, il est souvent présenté comme un esprit libre, courageux, et critique. Mais cette admiration hexagonale contraste fortement avec le regard que lui portent nombre de ses compatriotes, pour qui son discours semble tourner à la dénonciation systématique.
Une figure controversée
Sansal ne ménage pas l’Algérie. Ses livres, ses interviews et ses tribunes dressent le portrait d’un pays embourbé dans l’échec, la violence politique et la dérive religieuse. Son roman 2084 : La fin du monde, dystopie inspirée de George Orwell, a connu un grand succès en France, notamment pour sa critique virulente des totalitarismes à base religieuse. Mais à force de charges répétées, certains y voient une obsession plus qu’un engagement, et une posture qui finit par frôler le règlement de comptes.
Son propre parcours familial n’est pas anodin : on sait peu qu’une de ses grand-mères, de confession juive, aurait été tenancière d’un établissement de prostitution en Algérie durant la période coloniale. Cette trajectoire singulière nourrit une part de mythe personnel et d’ambiguïté sociale, dans un pays où la mémoire coloniale et les tabous sociaux restent sensibles. Il évoque rarement cet héritage publiquement, mais il façonne sans doute une partie de son regard.
Un critique très sélectif
On pourrait accepter sa virulence s’il appliquait sa rigueur critique à d’autres pays. Or, c’est là que la grille de lecture se trouble : pourquoi Sansal âgé de 75 ans et non 80 ans se montre-t-il aussi sévère envers l’Algérie, mais si discret sur d’autres pays qu’il connaît pourtant bien ?
Il ne critique quasiment jamais le Maroc, dont il est en partie originaire — un pays pourtant confronté à ses propres défis politiques et sociaux. Il ne dit rien non plus de la France, dont il a acquis très récemment la nationalité, et dont l’histoire coloniale en Algérie reste une plaie ouverte. Plus troublant encore : il s’est rendu à plusieurs reprises en Israël, où il a reçu un prix littéraire, sans jamais commenter les réalités géopolitiques ou sociales de l’État hébreu. Un silence d’autant plus notable que Sansal n’est jamais avare de mots lorsqu’il s’agit de pointer les travers de son pays natal.
Alors, l’écrivain est-il vraiment aussi libre et courageux qu’il le prétend ? Certains en doutent. Car la liberté intellectuelle implique aussi le courage de déranger ses alliés, pas seulement ses adversaires.
Une figure “de l’idiot utile” ?
Pour une partie de l’opinion française, Boualem Sansal incarne l’intellectuel arabe “lucide”, “débarrassé de ses illusions” et surtout “critique envers son propre monde”. Il rassure. Il conforte certaines idées dominantes. Et parfois, il permet même de dire ce qu’on n’ose pas dire soi-même, en s’abritant derrière ses mots.
Ce phénomène n’est pas nouveau : la France a souvent célébré les écrivains issus de son ancien empire dès lors qu’ils validaient un certain récit. Mais cela interroge. Le succès de Sansal en France est-il fondé sur son talent littéraire et son indépendance d’esprit, ou bien sur le fait qu’il exprime, de l’intérieur, un discours que la France aime entendre sur l’Algérie ?
Boualem Sansal incarne une forme de liberté intellectuelle, mais aussi ses contradictions. Il parle fort, mais pas partout. Il dénonce, mais pas tout le monde. Il dérange, mais de manière sélective. En cela, il devient malgré lui non pas un symbole mais un symptôme : celui des relations toujours conflictuelles entre l’Algérie et la France, entre mémoire et manipulation, entre vérité et usage politique de la parole.
Dans ce théâtre postcolonial inachevé, peut-on encore séparer la sincérité de la stratégie?