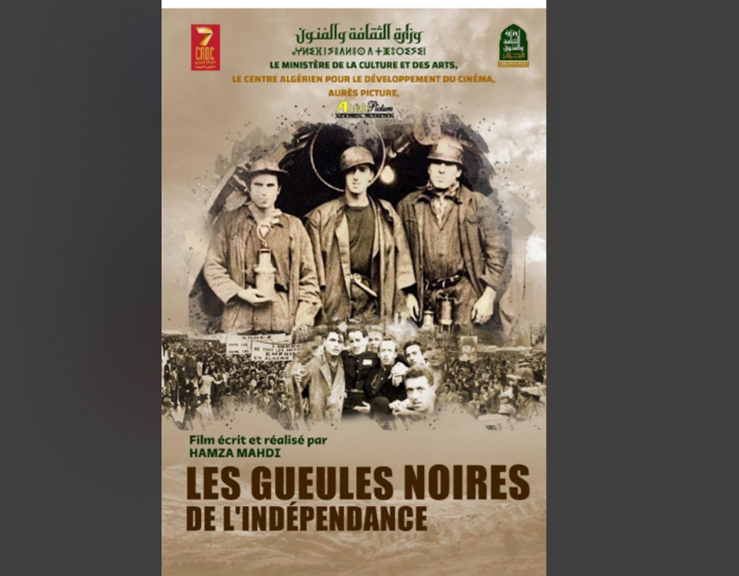Un 3ème extrait du livre de Lila Lefèvre : Grave dérapage de Bouteflika à la Commission européenne

« …L’ajout de cette anecdote est essentiel dans ce livre de confidences, car peu d’Algériens en connaissent les détails. Lors de sa seule visite d’État à Bruxelles, Abdelaziz Bouteflika a mené une série de rencontres de premier plan, dans un contexte diplomatique où il naviguait avec habileté, mais où l’on peut aussi entrevoir des choix discutables. Cette visite, multiple dans ses objectifs, comportait trois volets. En premier lieu, elle le menait au Royaume de Belgique, où il a rencontré le roi Albert II, le Premier ministre Guy Verhofstadt, le président du Sénat Herman de Croo, et le président du Parlement Armand De Decker. Même Louis Michel, ministre belge des Affaires étrangères à l’époque, lui accorda une attention particulière, avec pour mission de cultiver un lien d’amitié solide avec Bouteflika — une relation sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais nous y reviendrons.
Bouteflika a également rencontré Lord George Robertson, secrétaire général de l’OTAN, et a poursuivi sa visite en se rendant à la Commission européenne pour un entretien avec le président de la Commission Romano Prodi. Leur échange visait principalement à aborder les négociations en cours pour les accords d’association entre l’Union européenne et l’Algérie. Bouteflika, résolu à aligner l’Algérie sur les autres nations sud- méditerranéennes qui avaient déjà conclu de tels accords, espérait combler le retard accumulé par son pays. La décennie noire avait laissé l’Algérie exsangue, marginalisée par le terrorisme, et pour lui, il était impératif de réintégrer ce pays meurtri dans le giron de la diplomatie européenne.
Pour Bouteflika, cette présence en décembre 2001 à Bruxelles revêtait une importance stratégique. En orchestrant la signature officielle des accords d’association, il voulait inscrire cette rencontre historique dans les annales de son règne. Pourtant, ces accords, hâtivement conclus, manquaient de profondeur et de réciprocité. En tant que correspondante permanente de l’ENTV, j’ai été chargée de suivre chaque round des négociations, dont le rythme était précipité et la consistance discutée. Nombreux étaient les membres de la délégation algérienne qui semblaient davantage absorbés par les vitrines des boutiques bruxelloises que par les tables de négociation. Pressé par Bouteflika, impatient de boucler le dossier, l’accord s’est ficelé sous une pression évidente, souvent superficielle, pour que le président puisse faire parapher le document au plus vite et en tirer la gloire diplomatique.
Pourtant, en réalité, ce geste appuyait bien davantage son désir de briller sur la scène internationale que de défendre les intérêts de son peuple. Bouteflika, dans son ambition dévorante, semblait prêt à céder beaucoup, pourvu qu’il assure son image auprès de l’Europe. En face, l’Union européenne, forte de ses quelque 500 millions de citoyens et première puissance économique mondiale, n’avait qu’un interlocuteur : un chef d’État algérien persuadé de revêtir une stature napoléonienne — à une nuance près, se plaisait-il à dire, lors d’une interview avec la célèbre Ruth El Khrief : Napoléon mesurait 1,50 mètre, et lui… deux centimètres de plus.
Son empressement à conclure l’accord à tout prix, dans le seul but de glorifier son règne, aura laissé des traces. Quinze ans plus tard, en 2016, l’Algérie demandera une révision de cet accord déséquilibré, qui s’avérait bien plus favorable à l’Europe qu’à l’Algérie. Cependant, cette demande officielle n’a été formulée qu’après la chute de Bouteflika, sous l’impulsion du président Tebboune, qui a vu dans ce pacte un besoin impérieux de rééquilibrage.
Revenons à cette journée de décembre 2001. Le 22 décembre, Bouteflika a passé près de deux heures en aparté avec Romano Prodi, qui maîtrisait bien le français. À l’issue de cette rencontre, Bouteflika, s’adressant à un parterre de journalistes internationaux, dont je faisais partie, a prononcé une déclaration qui allait résonner d’un écho de stupéfaction :
« Vous savez, l’Algérie n’a même pas besoin de devenir membre associé de l’Union européenne, elle est déjà membre à part entière, car en 1957, à la signature des traités de Rome, l’Algérie était un département français. »
Ces mots, lourds de symboles et d’ambiguïté, ont jeté un froid. Ce n’était pas seulement une maladresse diplomatique. Cette affirmation heurtait le cœur même du peuple algérien, pour qui la guerre de libération avait constitué une épopée sacrée. La lutte contre le colonialisme français, ce long et douloureux combat, avait forgé l’identité de la nation. Ce n’était pas seulement une guerre ; c’était une conquête de dignité, d’indépendance, et de liberté.
Pendant plus de sept années sanglantes, des centaines de milliers d’Algériens avaient sacrifié leur vie pour arracher leur pays des griffes du colonialisme, rompant un siècle de soumission et d’injustice. Pour ceux qui avaient combattu dans les maquis, enduré les camps de concentration, déportés, ou assisté à la violence des répressions, cette déclaration de Bouteflika frôlait l’insulte. Elle réveillait des souvenirs amers et rappelait combien la liberté et l’identité algériennes avaient coûté. En évoquant la période où l’Algérie n’était qu’un « département français », il semblait minimiser cette page d’histoire — ce qui, pour un peuple qui avait chèrement payé son indépendance, était pour le moins douloureux.
Karl Marx disait que l’histoire se répète toujours deux fois, et en effet, plus de douze ans après les premiers discours de Bouteflika à Bruxelles, en 2013, la scène se rejoue avec une précision presque comique. L’homme qui fut conseiller de Bouteflika, puis ministre du Commerce, puis ministre des Finances, revient cette fois à Bruxelles en qualité de ministre des Affaires étrangères. Face à ses homologues européens, Mourad Medelci s’apprête, le ton solennel, à livrer une réplique vieillie qui semble sortie du passé. Interrogé par un journaliste sur les accords d’association entre l’UE et l’Algérie paraphés en 2001, et mis en vigueur en 2005, Medelci, fidèle à la formule et presque mécanique, répète sans sourciller : « Vous savez, l’Algérie n’a même pas besoin de devenir membre associé de l’Union européenne, elle est déjà membre à part entière, car en 1957, à la signature des traités de Rome, l’Algérie était un département français. »
Ces mots, loin de faire vibrer les imaginaires ou de ranimer l’orgueil national, rappellent une réalité crue : pour Bouteflika et Medelci, l’histoire n’est pas le terreau des rêves ou des grandes espérances, mais l’instrument d’une servilité revendiquée. Là où d’autres peuples puiseront dans l’histoire un souffle, un sursaut d’aspiration, eux n’y voient que la justification de leur propre posture : des colonisés, résignés à le rester. L’histoire devient alors non pas un récit d’émancipation, mais un écho douloureux, qui exagère les réflexes, entretient les vieilles blessures et plonge dans un délire de grandeurs révolues. Pour ces hommes, elle n’est pas un horizon de promesses, mais un refuge commode dans lequel s’ancre une fidélité à l’ancien ordre… »